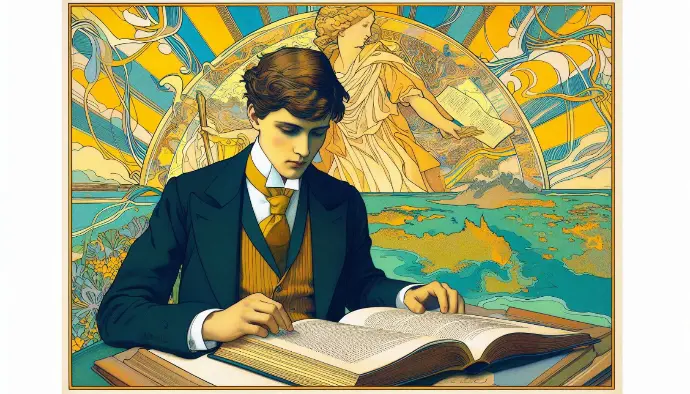
Introduction
Aperçu
L'hexagone : env 500k km² + outre mer 1.000k km²
ZEE ; env 6.3 mill’ km²
colonial
Jusqu’à la const’ 46, les Outre mers étaient soumis au régime colonial.
Jusque dans les années 60 existait un cours de « droit d’outre mer & de coopération » en raison de la décolonisation croissante emportant effet de proche collaboration, accompagnement diplomatique des nouveaux Etrats.
Ce n’est que récemment que l’on a constitutionnellement défini le territoire français incluant ses dépendances ultra marines :
actuel
Art 72 – 3 C58 :
nomme de manière exhaustive les
territoires ultra marins. On y comprend
aussi les terres australes (terres australes, antarctique, Kergelen, Adelie
etc) & Clipperton, territoires inhabités hormis pour missions
scientifiques.
CC 2003 474 DC
"Toutes les îles
côtières, ou au large des cotes françaises ne sont pas des outre mer."
Par conséquent, certains de ces territoires ne sont pas stricto sensu des CT, en ce qu’ils ne comportent aucune pop permanente et donc aucune rep’ locale (décentralisation).
Pour une partie de l’outre-mer, on pratique ce que l’on nomme le régionalisme politique, sur un modèle italo-hispanique.
Les colonies
La période coloniale est scindée en deux périodes, et distinguent deux régimes d'état civil :
Ces deux périodes sont impulsées par la corrélation, l’intersection de plusieurs actions privées soutenues par des intérêts publics : les commerçants et les missionnaires plantent le décor, les Etats souverains devant protection à leur nationaux les armées arrivaient ensuite.
On y distingue 2 types de territoires : Annexés (ex les territoires américains et Algériens etc) et les Protectorats : Maroc, Tunisie, Indochine, mais aussi Monaco (qui l’est toujours).
La Syrie et le Liban quant à eux ont été confié à la France ne 1920 par la SDN suite au démantèlement de l’Empire Ottoman consécutif à la 1ere guerre mondiale il ne s’agissait pas d’un protectorat mais plutôt d’une tutelle à vocation temporaire.
Le pouvoir législatif est exercé dans les colonies par le Pdt Rep & décrets coloniaux : la loi adoptée par le parlement Français n’est pas en principe applicable dans les colonies.
Dans les territoires annexés l’ensemble de la population est nationalité française, cependant il y est fait une distinction au sein des nationaux : « citoyens français » & « sujets français ».
La décolonisation
La plupart des territoires vont devenir indépendant, comme l'Indochine (7 ans), Maroc & Tunisie.
La question est relativement simple pour les protectorats dont les Etats existait avant ledit protectorat, comparé aux territoires annexés dont les Etats n’existaient pas forcément avant.
Le référendum constituant : pour les territoires
d’outre mer il avait valeur de ref d’autodétermination.
S’ils refusaient la
const’, cela valait valeur de déclaration d’indépendance reconnue par la
France.
Un seul a voté contre : la Guinée.
La Const’ de 58 comportait des dispo permettant de faciliter, de manager ce processus décolonial .
Pour les autres territoires, l’article 76 de la Const leur offrait une option : transformation en dpt d’outre mer, maintien du statut de territoire d’outre mer, ou transformation en Etat associé membre de la communauté française.
La plupart des Etats d’Afrique Noire ont voté pour le statut d’Etat associés.
Juridiquement, ces Etats sont sortis de l’Etat de la
République Française, et les 10 années suivantes, ont progressivement rompu
leurs liens autres que diplomatiques et économiques.
En 1965 ne reste donc plus que des territoires ou des dpt d’outremer.
Dpt : Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyanne, "Les 4 vieilles".
Territoire : Nlle Caledonie, PF, wallis & Futuna,
Les commores, Cote Française des Somalie (Djibouti).
Depuis 65 deux territoires ont fait sécession : Cote Française des Somalie devenue territoire des Afars et Issa (afin de modifier le code de la nationalité pour faire voter les personnes sans nationalité par leur nomadisme), puis Djibouti ; et les Comores.
L'outre mer actuel
Les collectivités ultra marines relèvent soit de l’article 73c (anciennement Dpt d’outre mer) soit du régime de l’article 74c (anciens territoires d’outre mer)
De 1958 à 2024, plusieurs évolutions constitutionnelles, du simple au complexe.
- Soit les gens veulent français et à terme devient Dpt Fr
- Soit les gens veulent l’indépendance, alors les territoires d’outre mer servent uniquement de passerelle.
Selon le choix : il fallait donc lui appliquer le statut de dpt avec prise en compte de spécificité locales ; ou alors en tant que territoire, on lui flanquait des règles d’organisation propres et fortement dérogatoire au droit des départements.
Or la création des Régions en 82 vient chambouler le game : On va alors créer des régions sans département, on confiant à la dite région les comp’ du dpt, mais censure du CC car la Constitution ne connait pas des régions (création légale), ce qui fait qu’il y a du exister des dpt / régions doublons : dpt & Région de la Réunion, chacune excerçant ses propres comp avec ses propres assemblées.
Aujourd’hui, une seule assemblée réunie les comp de la Région & Dpt, dès lors que le consentement des électeurs de la collectivité a été acquis : Art 73 alinéa 7c.
Rapidement actée en Martinique, mais pas en Guadeloupe.
Les CT d’outre mer ne sont ainsi pas des départements au sens administratif du terme, mais des collectivités à statut particulier.
En 2003 on modifie l’article 73 afin que ces adaptations soient décidées par les autorités locales et non plus le législateur.
Cela veut dire qu’une autorité administrative pourra ajouter des éléments à la loi.
Concernant l’article 74 :
Ne comportait qu’un alinéa : » Les territoires d'Outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi aprés consultation de l'assemblée territoriale intéressée. »
Aujourd’hui il en compte 12.
La modification de 2003 touche aussi l’article 74.
Il défini à minima ce que doit contenir le statut, ce « qu’est » un territoire d’outre mer. Il défini aussi la notion d’autonomie constitutive entre autre par la capacité de la CT de saisir le CC pour une loi qui empièterait sur ses statuts.