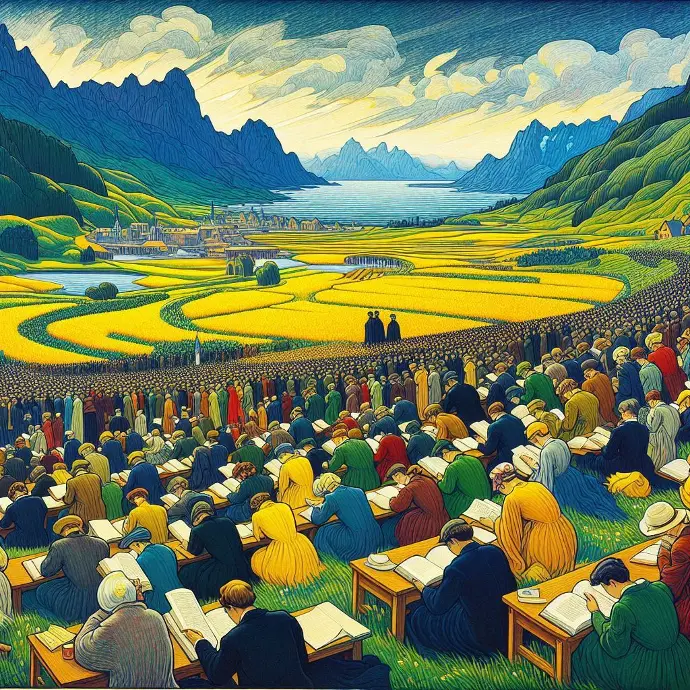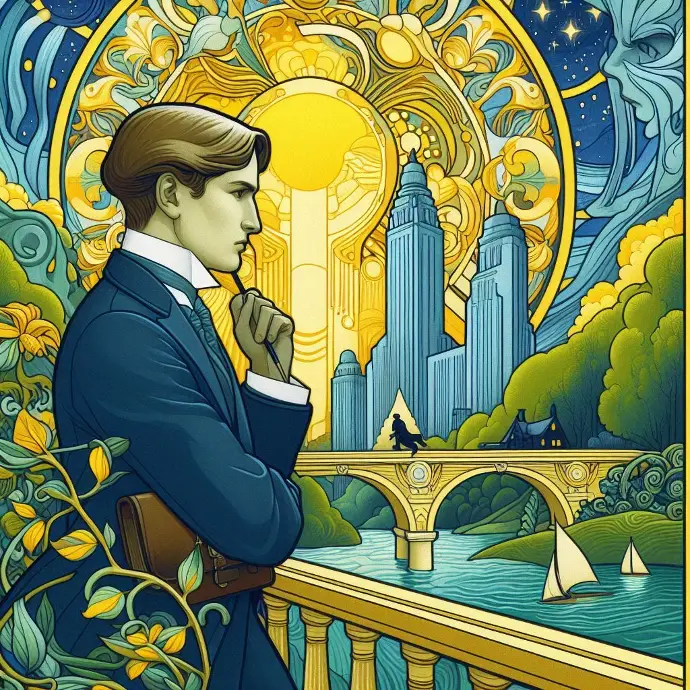le pollueur payeur
corolaire de la responsabilité environnementale
« Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. ».
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. ».
L’Union européenne est confrontée à des problèmes environnementaux complexes, qui vont du changement climatique et de la perte de biodiversité à l’épuisement des ressources et à la pollution. Pour remédier à ces problèmes, la politique environnementale européenne se fonde sur les principes de précaution, de prévention, de correction de la pollution à la source et du «pollueur-payeur».
Ce principe, il est consacré de façon expresse par l’acte unique européenne du 17 février 1986, complétée par certaines directives, consacré en droit interne, par la Loi Barnier du 02 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement. Aujourd’hui c’est l’article L110-1, II le 3ème principe.
On en trouve aussi une trace dans la charte de l’environnement mais qui s’exprime aussi en terme plus généraux à l’article 4 : "« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. »"
La responsabilité environnementale dépend de ce principe.
Ce principe signifie que les pollueurs doivent assurer les dépenses générées par la lutte contre les pollutions.
C’est une logique de réparation et de prévention. Il y a des prolongements concrets, la taxation des pollutions c’est l’écotaxe, et divers dispositifs de compensation. En France, les éco-taxes se sont multipliées, depuis 1999, certaines taxes ont été regroupées dans une taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP).
On trouve un autre mécanisme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre venu des US en 2005 l’UE a mis en place un système de « plafond » des émissions de gaz à effet de serre, pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto, on a introduit dans les secteurs polluants que les opérateurs doivent chaque années mesurer et vérifier leur émission puis restituer autant de quota que leur émission vérifiée de l’année N-1. 1 quota = 1 tonne de CO2.
Pour restituer les quotas les entreprises peuvent en racheter, on rachète des quotas en payant, soit d’autres participants, soit aux enchères.
Le nombre de quotas mis sur le marché, correspond au plafond fixé par l’UE de façon à atteindre ses objectifs climatiques. L’UE fixe un plafond d’émission de gaz à effet de serre. Les objectifs climatiques de l’UE c’est l’équilibre ou la neutralité climatique à l’horizon 2050, l’UE s’est engagée pour respecter le protocole de Kyoto, à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépasse pas leur absorbation dans les puits de Carbonne. Le plafond de quota diminue chaque année. Le prix du carbone lui, augmente pour avoir un effet dissuasif.
Problème, le système s’apparente à un véritable marché d’émission et d’échange de quota de GES.
La mise en place du marché des Quotas des émissions de GES et son effet fait dire à certains que le principe pollueur-payeur a été détourné et devient un principe payeur-pollueur, l’entreprise qui a les moyens peut polluer, c’est censé être un mécanisme transitoire.

Les principes directeurs du droit de l'environnement
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dite " loi Barnier " ( JO 3 févr. 1995, p. 1840 ) a institué les principes généraux du droit de l'environnement français.
Ils sont mentionnés à l' article L. 110-1 du Code de l'environnement.

Prévention & précaution
Ce principe vise à combattre non le dommage, mais la menace d’un dommage.
Les procédures de prévention, visent les cas dans lesquels le risque est connu, certain même si le dommage lui, n’est qu’éventuel. Ce principe de prévention a été consacré très tôt en droit international Sentence arbitrale 1941 l’affaire de la fonderie de Trail.
L’affaire opposait les US et le Canada, pour des faits qui remontaient au début du XIXème siècle, au Canada, il y avait une fonderie de Zinc et de Plomb qui émettait du gaz de Plomb et de Souffre, cela a porté atteinte aux terres agricoles des US, donc le litige a commencé entre les agriculteurs et l’exploitant, des procédures de droit privés ont commencé, c’est remonté entre les états avec des accords bilatéraux et ensuite, un compromis d’arbitrage est signé en 1935. Dans cette affaire, le Canada est reconnu comptable d’émission polluante qui ont causé un préjudice à des tiers, à cette occasion, une indemnité a été décidé et le juge a consacré un principe selon lequel, tous les états, doivent s’assurer qu’ils ne risquent pas de causer de dommage à l’environnement dans leur activité.
Ce principe a été repris par les conventions internationales et en droit de l’UE à partir de 1973, date du premier programme des CE en matière d’environnement, qui ensuite était complété par des directives.
charte de l’environnement – art 3 :
« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ».
L110-1 - code env.
« Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.
Ce
principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire
tendre vers un gain de biodiversité».
Ce principe de prévention est en réalité mis en œuvre dans de nombreux textes sectoriels prévoyant des autorisations préalables à l’exercice d’une activité susceptible de porter atteinte à l’environnement ex : activités industriels polluantes, dans le cadre de l’instruction l’adm met en œuvre le principe de prévention/ OGM/ la réglementation et la prévention des risques naturels et technologiques.
La prévention repose le plus souvent sur une évaluation de l’impact environnemental d’un projet ou d’une activité (public ou privé).
Il va s’agit d’apprécier, d’évaluer à l’avance les effets sur l’environnement que pourrait avoir un projet une construction ou une activité. Cela passe par une étude d’impact, très encadrée par les textes, et le droit de l’UE qui a posé un cadre. Aujourd’hui l’étude d’impact est régie aux article L122-1 à 3.
Le juge en cas de contentieux, s’appuie régulièrement sur le principe de prévention ou le principe d’action préventive, c’est notamment le cas du JA en matière d’expropriation : CE 2018 « Commune de Villiers-Le-Bâcle » à propos de la construction de la ligne 18 du métro dans le cadre du projet du grand Paris. Le JA considère que si la nature du projet le justifie, la déclaration d’utilité publique doit préciser, au moins dans leurs grandes lignes, les mesures destinées à réduire, voire à compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. Le JA exige que l’adm ai identifié le risque et prévue dans son dossier des mesures de prévention ou de compensation.
le principe de précaution vise les hypothèses dans lesquels le risque de dommage n’est pas certain,il pèse donc sur la survenance du dommage et la réalité du risque.
Il faut donc un certain nombre de condition :
- C’est un principe qui ne s’impose qu’aux autorités publiques.
- L’environnement doit risquer d’être affecté de manière grave et irréversible. Il s’agit donc d’un risque important, c’est donc un élément de subjectivité. C’est un facteur d’insécurité juridique, il s’agit de conditions floues.
- Les mesures à prendre, qui s’imposent à l’administration, ne sont que provisoires et proportionnée. Elles doivent être prises dans l’attente des avancés scientifiques.
- Le cout doit être « économiquement acceptable ».
Ces conditions découlent de l’article 5 de la charte de l’environnement, qui a consacré.
charte de l’environnement – art 5 :
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
L110-1 code de l'env.
Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.
Il suscite de nombreux débats, à la fois dans la doctrine, devant les médias et devant le juge, on lui reproche de constituer un frein à l’innovation et donc un frein à la croissance et de paralyser la recherche. Ce principe de précaution, revêt une valeur constitutionnelle, le juge n’hésite pas à le rappeler. Le JA l’utilise prudemment, arrêt d’assemblée 12 avril 2013 .
« L'adm doit prévoir des mesures de précaution suffisantes pour éviter la réalisation d’un dommage grave et irréversible pour l’environnement, dès lors qu’un tel risque existe ».
"une opération qui méconnait les exigences du principe de précaution, ne peut légalement être déclarée d’utilité publique."
En l’espèce le CE a reconnu le caractère plausible d’un risque pour l’installation d’une LHT, cependant il juge que les mesures de précaution adoptées n’étaient pas manifestement insuffisantes. Contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. principe de sécurité juridique aussi lors du revirement de jurisprudence.

L'information, la participation, la concertation
Le droit à l’information est un préalable indispensable à toute personne permettant de faire respecter ses droits.
Rattachable naturellement au principe de transparence de l’action administrative (le droit d’accès aux doc admin – la CADA), consacré depuis un bail : loi juillet 1978 sur la communication des documents administratifs, désormais Livre 3 du CRPA.
Ce droit est proclamé à la fois au niveau international, européen et en droit interne.
Il s ‘agit du 10ème principe de la déclaration de Rio (1992) ; qui se trouve aussi dans la convention d’Aarhus 1998 (Participation du public au processus décisionnel, à l’information et accès à la justice environnementale)
Source Européenne : directive du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement.
Source interne : Art 7 Charte environnement. Il s’agit des infos publiques donc de l’administration. & L110-1 II/ 4) :
Elle
repose sur la volonté de l’administration d’organiser des rencontres &
débats avec les citoyens. Elle peut être obligatoire, par
exemple en matière d’aménagement urbain : les projets d’urba sont précédés
d’une concertation. Cette obligation pèse alors sur la commune.
Elle est cependant le plus souvent facultative.
La concertation a pris une ampleur nouvelle, inédite, dans le cadre de la Convention Citoyenne sur le Climat : initiative du président Macron qui s’est inspiré de l’exemple irlandais et qui a permis l’organisation de débat entre 150 citoyens tirés au sort dont l’objectif était de définir une série de mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport à 90 d’ici 2040.
149 propositions ont été remises, le gouv a annoncé en avoir retenu 146. Parmi celles écartées réduire la vitesse max à 110km sur l’autoroute.
La CNDP :
La commission nationale du débat public, mise en place en 1995 est aussi un acteur de la concertation. Elle vielle à la concertation du public sur des projets d’aménagements qui entraînent des répercussions significatives sur l’environnement. La CNDP organise des débats publics et en rend public les conclusions.
- Simple concertation, organisé par un garant local (300)
- Débat public, organisé par la CNDP elle-même, débat formel, long.
La CNDP n’est là que pour veiller à la qualité de l’information par le porteur du projet, et un coordinateur d’échange entre le porteur de projet & le public. Le public pose une question et l’aménageur lui répond. La Commission ne va jamais donner son avis.
Dans certains cas le projet peut même être abandonné, c’est le cas du projet de terminal méthanier sur le territoire de la commune de Verdon sur Mer (embouchure estuaire de la Garonne), le débat est organisé en 2007 et 2009 le projet est officiellement abandonné.
La CNDP est régie par les dispositions L121-1s du code de l’environnement, et donc sa saisine.
- Les cas de saisine obligatoire par le porteur de projet : caractéristiques & montants du projet sur la base desquels on pense qu’il y aura un impact significatif sur l’environnement.
- Le ministre de l’Environnement
- Par l’intermédiaire du préfet par une asso agréée, ou bien 10k citoyens. Le préfet joue le rôle de filtre.
- Pour les projets de réforme constituant des enjeux de société, il est aussi possible à 60 députés ou sénateurs de saisir la CNDP si personne ne l’a encore fait. Par exemple l’enfouissement des déchets nucléaires.
- 500k ressortissants de l’UE résidant en France pour les projets de réforme (idem supra).
La CNDP ne peut pas s’auto saisir.
La participation repose sur le doit à l’information et à la concertation, c’est le droit reconnu au citoyen de participer au processus décisionnel en matière environnementale.
Pour les sources I, il est consacré par la convention d’Aarhus en 1998, elle fait nettement le lien entre participation et information. Article L110-1 du CDE dont il figure au 5èmement du II : « Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. ».
Il s’agit de la conséquence du droit à être informé et c’est le droit de se faire « entendre ». il s’agit de l’obligation de prendre en considération les observations des citoyens. Le principe de participation n’est donc pas très engageant.
Le code de l’environnement revient sur le principe de participation dans une autre disposition, à l’article L120-1, dans cet article, le code énonce les objectifs du principe de participation et il précise les droits reconnus au public, au citoyen pour atteindre ces objectifs. Carré Galinot – droit de l’environnement.
Voir tableau moodle.
Les objectifs :
- Améliorer la qualité de la décision publique.
- Assurer la prévention sur l’environnement.
- Améliorer et diversifier l’information environnementale.
- Sensibiliser et éduquer le public à la protection de l’environnement.
Les associations de protection de l’environnement
Elles occupent une place importante dans ce processus de participation du public à la prise de décision en matière environnementale.
Leur rôle est reconnu par le droit français dès le début des années 1970, le 02 avril 1971, un décret affirme le rôle des associations de protection de l’environnement en matière de concertation et de participation.
Elles sont nombreuses, il est difficile de déterminer un chiffre car certaine sont un objet plus large, il y en a entre 15k et 40k qui intervienne pour la protection de l’environnement en France. L’objet peut donc être particulier ou général, France nature environnement, Greenpeace, la ligue de protection des oiseaux, …
L’UICN, c’est l’Union International pour la Conservation de la Nature. Il s’agit d’une ONG mondiale, document publié chaque année sur la liste des espèces menacées, publiée sur la base des inventaires scientifiques (ex du thon rouge). WWF aussi.
De façon générale, en droit français les ONG prennent la forme d’association, elles se déclarent en préfecture, avec un dossier de déclaration qui est fait. Elles peuvent aller au-delà, en demandant un agrément par l’état et même une habilitation à participer aux débats sur l’environnement. Elles sont très souvent à l’origine de la saisine d’un juge. Est-ce qu’il a une existence autonome ? pas vraiment pour le moment.

Principe de non regression
Il s’agit d’un principe assez récent, puisqu’il a été formulé par la Loi du 08 aout 2016, sur la biodiversité. Il vise a orienter de façon générale, l’action des pouvoirs publics en matière environnementale en leur interdisant de remettre en cause des avancées acquises. C’est un « effet cliquet ».
C’est un principe de valeur législative, il figure dans les grands principes de l’art L110-1 du CDE, au 9 du II.
L110-1 9° code de l'environnement :
« Le
principe de non régression, selon lequel la protection de l'environnement,
assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ».
Il faut attendre les prises de position du juge pour savoir dans quels cas il est appliqué. Décision du CC qui a été saisie de la loi sur la biodiversité en 2016, décision le 04 aout 2016 737DC, relative à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans cette décision le CC a précisé que le principe n’a pas valeur constitutionnelle et qu’il ne s’impose doc qu’aux pouvoirs règlementaires et pas au législateur. C’est une restriction à l’effectivité du principe.
JA fait la première application du principe de non régression, dès lors que le projet ne contient pas de risque sérieux pour l’environnement :
« ne constitue pas une régression le fait, d’alléger les procédures d’autorisation en remplaçant l’évaluation systématique par une évaluation au cas par cas pour les projets qui ne présentent pas de risques réels pour l’environnement »
En revanche, viole le principe de non régression, l’acte règlementaire qui supprime par principe, toute évaluation de projet susceptible de présenter un risque pour l’environnement.
Deux autres précisions apportées par la JP administrative :
- Le principe de non-régression n’est applicable qu’aux actes règlementaire, et pas aux décisions individuelles (autorisation d’exploiter une ICPE, on ne peut pas l’attaquer en arguant d’une violation directe de l’acte individuel, il faut utiliser l’argument de l’illégalité de la règlementation sur la base de laquelle l’acte administratif individuel est pris.)
- Le principe, peut être écarté, n’est pas opposable a un acte règlementaire dans deux hypothèses dégagées par le CE.
=> Lorsque le législateur lui-même a décidé d’en écarter l’application dans un domaine particulier (la loi entend déroger au principe de non-régression).
=> Le principe peut être écarté lorsque le législateur, a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir règlementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre, des dérogations qu’il a lui-même prévu à ce régime.
Ces deux cas de figure, ont été données par un arrêts récent, du 27 mars 2023 « associations réseau sortir du Nucléaire.». On peut se demander si le principe n’est pas encore un coup de « com ».

developpement durable & principe d'integration
C’est un concept, qui est né à la fin des années 60, il a été défini dans un rapport publié dans le cadre de l’ONU. Le développement durable est un « développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
à le droit des générations futures à voir en DLF + Droit de l’environnement. 2023 CC nucléaire.
Il s’agit du rapport Brundt Land – Norvégienne qui présidait la commission mondiale sur l’environnement et le développement, sous sa présidence ce rapport a été publié (1987).
Ce rapport prend en compte trois finalités générales, présentées comme indispensable et indissociable :
· Le développement économique
· Le progrès social
· La préservation de l’environnement
Le développement durable a été consacré dans un certain nombre de traité et constitue le 3ème principe consacré par la déclaration de Rio du 12 aout 1992, sur le développement et l’environnement. « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire …. Des générations présentes et futurs ».
En droit interne, a charte de l’environnement consacre ce droit – art 6.
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. ».
Aussi, dans le CDE, l’article L110-1 fait référence aussi au développement durable présenté comme un objectif reposant sur 5 engagements :
o La lutte contre le changement climatique,
o La préservation de la biodiversité des milieux et des ressources
o La cohésion sociale et la solidarité entre les générations et les territoires
o L’épanouissement de tous les êtres humains
o Le transition vers une économie circulaire
Ne s’agit-il pas d’un concept qui s’est banalisé, se réduisant à un vœux ? c’est un objectif. Le développement durable oblige les opérateurs publics à procéder à des évaluations, des anticipations et des bilans plus poussées, complets et précis.
Art 6 chart env 2004 : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »
Connexe au DD, il permet d’imposer la prise en compte des PB environnementales dans toutes les autres politiques publiques mises en œuvre.
responsabilite administrative environnementale
Répond aux règles générales de la resp administrative.
Le contentieux est complexe en raison de la nature du dommage environnemental : le préjudice est rarement direct, certain et personnel, tout au contraire.
La preuve est alors difficile à apporter pour convaincre le juge que le préjudice subit doit être rétabli.
Le législateur a parfois mis en place des régimes spéciaux de responsabilité qui écartent la nécessité de prouver la faute de l’administration :
En matière nucléaire : Loi 1968 & 1990
Dans d’autres cas lorsque le dommage est généralisé et particulièrement grave, des fonds d’indemnisation sont mis en place par la loi, ex risque naturels, dommages liés à l’amiante, et pollutions par hydrocarbures (marées noires).
En sus 1, la consécration du préjudice écologique « pur » par la Cour de cass : un préjudice qui touche non pas une personne mais un élément de l’environnement en lui-même Cass crim 2012 Erika : Il est quasi impossible de chiffrer les dommages d’un dégât à l’environnement, pour l’essentiel la réparation s’est fait en nature au travers du remboursement des dépenses de remise en état.
A reconnu la perte de chance, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.
Deux amendes : pénale 300k, et civil env 200 millions.
En sus 2 : la reconnaissance d’une criminalité climatique. Le JA reconnait l’existence d’un préjducie climatique global dans l’Affaire du Siècle, et a condamné l’Etat pour son inaction climatique (TA Paris 2021 & CE 4 aout 2021 : recours assos amis de la terre, prononciation de l’astreinte), les sommes ont été distribué entre les assos requérante, l’ADEM, l’ANSAET, Air Parif’
Les asso de préservation de l’environnement dont les Amis de la Terre ont à nouveau saisi le JA en octobre 23 pour un jugement décembre 2023, mais le TA paris les a débouté : elles réclamaient une nouveau versement d’astreinte. Le Juge a estimé que l’Etat avait mis en œuvre un certain nombre de mesure qui allait dans le bon sens, à la fois pour mieux respecter ses engagements et réparer le préjudice écologique.
Cela montre que l’efficacité contentieuse est proportionnelle à la précision des normes contraignantes : plus l’objectif est clair, chiffré, daté, plus il est facile de le contraindre que cela soit sur la base d’engagement internationaux ou de mesures internes.