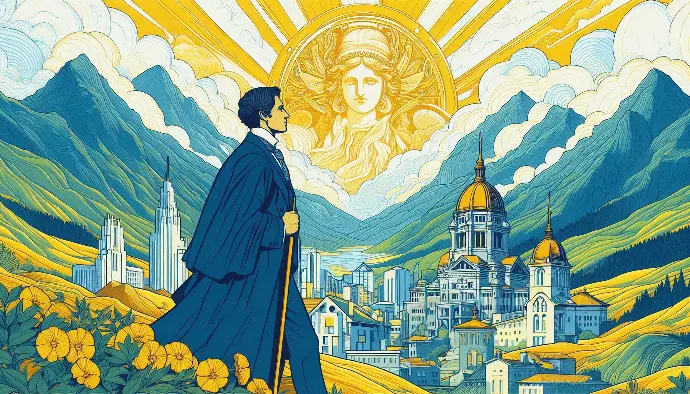Introduction
Definir le droit de l'urbanisme
Il s'agit de l’ensemble des règles concernant l’affectation de l’espace et son aménagement
Il énonce une règlementation et prévoit des sanctions en cas de non-respect ce qui en fait une police administrative spéciale.
Ce droit de l’urbanisme poursuit une vision d’intérêt général et le place dans la sphère du droit public avec les conséquences qui en découle, les règlementations et des prérogatives exorbitantes de droit commun (préemption et expropriation, soumission à des servitudes sans indemnisation, …).
Contexte historique
L’existence d’un droit de l’urbanisme au sens d’un ensemble de règles, relatives à l’affectation de l’espace et à son aménagement n’est pas une nécessité première pour assurer une vie sociale à la différence des règles civiles, pénales ou encore des règles fiscales.
Ceci explique une constitution récente au cours du XXème siècle et arrive à maturité à la fin de ce XXème siècle.
Il y avait néanmoins des règles éparses d’urbanisme, d’abord inspirées par des considérations d’ordre public on peut évoquer un édit, celui de Sullis de 1607, qui est relatif à l’aménagement des voies publiques, posant le principe de l’alignement, qui sont toujours aujourd’hui en vigueur. Certaines règles du code civil de 1804 ont pour objet d’assurer des relations de bons voisinages et donc de sauvegarder l’OP telles que les différentes servitudes (distance, égout, toit...).
Certaines considérations relatives à la police administrative nourrissaient l’embryon, par exemple la sécurité publique : un décret de Napoléon premier de 1810, posant les règles concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres.
Les principes édictés à l’époque se retrouve aujourd’hui au niveau des ICPE (Istallation Classées pour la Protection de l’Environnement). Autres préoccupations : la salubrité publique avec un décret-loi du 26 mai 1852 (2nd empire) inspiré par le Baron Haussmann qui fait obligation au constructeur d’aménager des réseaux de canalisation.
Puis à la fin du XIXème siècle, de nouvelles inspirations voies le jours, en lien avec le romantisme des préoccupations d’esthétisme et de conservation du patrimoine (2ème moitié du XIXème siècle). Tout ceci conduit d’une part à des recensements des constructions remarquables qui pouvaient exister (constructeur flèche Paris) pour enfin produire la loi de 1913.
Abbé Grégoire à terme de vandalisme.
Au début du XXème siècle, l’objectif de planification va apparaître, c’est cette idée de planification qui donne à l’urbanisme sa véritable identité.
La loi Cornudet
La première loi d’urbanisme française est la loi du 14 mars 1919 (-de 6 mois après la fin de la 1ere GM), la loi Cornudet.
Elle conclue, des travaux législatifs qui avaient commencée en 1909 (10ans). Il fallait doter la France d’une législation comparable à celle de pays voisins comme la GB ou encore les Pays-Bas. cette loi prescrit l’établissement dans une durée de 3ans de l’embellissement pour les villes de plus de 10k habitants, les villes sinistrées par la guerre ou celle présentant un intérêt particulier.
Ces plans devaient concerner tous les aménagements de la ville (voiries, espaces verts, …) ces plans étaient élaborés sous l’autorité des préfets (pas la commune) c’était un acte de l’état. Les services attachés aux préfets établissent les plans sur la base d’un « zonage », avec des possibilités de construction.
L’arret Laine 1932
Ce zonage est attaqué devant le CE (arrêt de 1932 LAINÈ), il admet la légalité du zonage. Arrêt très important car il donne l’accès du droit de l’urbanisme, un droit de planification fondé sur un zonage, aujourd’hui :
- zone urbaine
- à urbaniser
- naturelle
- agricole.
La loi lotissement 1924 : les bases de l’urbanisme reglementaire.
Cette loi de 1919 est complétée en 1924 par une autre loi fixant les règles concernant les lotissements en les soumettant pour la première fois à une régime d’autorisation administrative préalable. On découpe une parcelle cadastrale en plusieurs lot, en déterminant au sein d’une propriété un certain nombre de parcelle à vendre pour construire (avant 1924 c’était donc libre). Décret-loi de 1924 en déterminant que sur tout le territoire on puisse régler les problèmes d’intercommunalité premier plan en 1932 pour Paris.
Ces lois, ont contribué à faire ce qu’est l’urbanisme aujourd’hui, un droit de planification fondé sur un zonage, avec la question de l’intercommunalité et les autorisation préalable données aux propriétaires. Ces lois n’ont pas été suffisamment concrétisé, efficace, car il n’existait pas d’administration centrale spécialisée susceptible de faire en sorte que la loi s’applique. 15 juin 1943 loi de Vichy, services spécifiques d’urbanisme au sein de l’état, avec des services centraux (ministère) et déconcentré (préfecture).
Cette loi généralise le permis de construire dont l’objet est d’assurer le contrôle du respect des règles d’urbanisme : c’est la base de l’urbanisme réglementaire.
Au lendemain de la 2nd GM, la demande en reconstruction est grande, et conduit à l’apparition de l’urbanisme opérationnel à travers l’opération de procédures spécifiques.
L’arrEt EFINIEF
Arrêt EFINIEF, avec l’instauration des « ZUP (Zone à Urbaniser par Priorité) »
La Loi Malraux
La loi Malraux accélère la restauration urbaine, durant cette période et jusque dans les années 70 la Puissance Publique organise la création de villes nouvelles ou de nouveaux quartiers avec le double souci d’accueillir une population en plein essor.
.
Rapidement le cadre urbain et communal apparait trop rigide, et il apparait nécessaire que la planification devienne flexible en 1967 le législateur instaure deux documents afin de distinguer les deux finalités reconnues au droit de l’urbanisme :
Prévoir – prospectif : les SDD (Schèma Directeur Décentralisé) qui comportent des règles incitatives concernant l’espace supra-communal, visant le long terme et inopposable aux administrés, ce sont les ancêtres des schémas de cohérence territorial actuel)
Règlementer – immédiat : Les POS, les plans d’occupation des sols, comportant les règles impératives qui concernent le cadre communal, qui vise le court terme et opposable aux administrés, les ancêtres des Plans locaux d’urbanisme (cadre communal ou intercommunal)).
On peut s’interroger sur les finalités du droit de l’urbanisme.
C’est la concrétisation des
politiques publiques d’aménagement de l’espace.
.