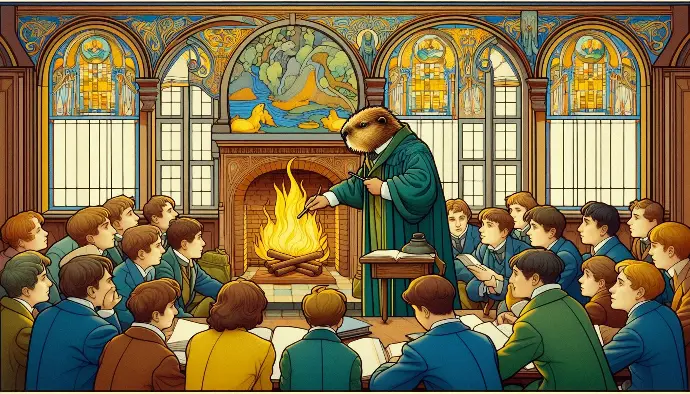
Politique publique : une affaire de recit
une affaire de recit
Forment la rationalisation politique
L'idéologie est l’agglomération de nos propres concepts
(eidos – Logos), lorsque l’idéologie est partagée, racontée, et acceptée
de manière suffisamment large, elle devient un paradigme.
La puissance est alors calculée selon la capacité paradigmatique : l’Etat peut faire apparaître des choses de la seule force de sa décision fondée sur son récit, car il est paradigmatique => la signification de ce qui est véhiculé est stabilisée.
La force de ce récit, pour éviter une concurrence trop rude, est de créer le problème par le seau de l’intérêt général (ce n’est pas mon problème, mais celui de tout le monde).
Il s'agit de contrecarrer les parties prenantes par l’acclimatation à son discours, au travers d’outils tels que les « experts », les sondages, les chiffres, les effets de discours rhétoriques : on convainc, donc on attaque la raison..
Cette approche par le récit forme L’approche pragmatique jurisprudentielle permet de démontrer que la construction de la jurisprudence se fait dans la recherche de l’adhésion, au travers du courant réaliste qui permet d’aller chercher des opérateurs non juridiques, « on popularise le droit ».
Cette approche permet de voir la jurisprudence en plusieurs dimensions ainsi que le fait politique devenant fait juridique : La décision.
Ce qui s’énonce, c’est ce qui ne va pas de soi, donc l’installation de l’évidence pour ne pas tomber dans l’écueil de la complexité. Le récit est épaissi, raconté par un langage réduit aux mots valises, des concepts mobilisateurs
Le rôle de l'article 34c dans le recit
L'epoque de l'evaluation
La rationalisation mène au contrôle.
La modification de la C54 2008 « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
La fonction législative a glissé vers le Gouv (du fait de la mécanique de la C58), alors le parlement est devenu un superviseur de la politique publique.
Dans la Constitution de 1958, le contrôle de la politique publique est réalisée en partie par l'Etude d'impact. Souvent le pb de l’inconstitutionnalité de la loi est organique : il manque le contrôle par l’étude d’impact.
Cela inaugure l'époque « d’évaluation », les Politiques publiques sont elles Effectives ?
Effective : efficience ET/ OU efficacité. L’efficience économique d’une part, et quel impact dans le réel d'autre part.
L'evalution ne peut se faire que par referentiel
Quels repères, quels critères, quels dashboard (tableau de bord) utiliser ?
Peu à peu on rentre dans
une gouvernance par les nombres : seuil, niveaux numériques, qui donnent
un sens de « mesure », qui donnent naissance à des dispositions techniques, une réduction de la
réalité à sa description numérique.
A titre d'exemple : la veille distinction de la carte et du territoire, où la carte n’est que la description dans un certain langage dans le territoire. Si le territoire est décrit par une matrice numérique, on simplifie et ne rend compte que de certains aspects.
Dans les admins, comment déterminer un critère pertinent pour évaluer son action ?
L'evalution par les nombres, production de recit.
Pour répondre à la question de la détermination du critère d'évaluation, la tentation est évidemment grande d’établir une gamme de critère qui n’ont d’autres but que de valoriser la propre production de l’admin.
La gouvernance par les nombres offre des facilités de prise de décision « en apparence » : Automation & Mécanisation du processus décisionnel, à une époque où l’on parle de « Smart ». le processus de décision peut emprisonner l’opérateur et le priver de son pouvoir de décision.
L’autre problème est le rapport au réel :
La gouvernance par les nombres induit l’applatissement du réel, car on y perd des dimensions. Avec la gouvernance par les nombres le monde est en apparence clos, et total. « Je peux parfaitement décider sur le réel
Pour d’autre la profondeur du réel ne peut être mesurée par la gouvernance par les chiffres.
Quel est le rôle de l’Etat par rapport à ça ? Dans cette mise en oeuvre de la gouvernance par les chiffres, a-t-il était amené à évoluer ?
Depuis les années 2010, le discours sur les transformations publiques faisant de l’Etat un « Etat Plateforme » (Rapport CE 2017, Cour des comptes 2018). L’utilisation des métaphores tels que « France a startup nation », l’Etat « porte avion », cache ce qui n’est pas possible de dire( le but de la métaphore ).
Depuis quelques années, on remet en cause la logique de l’Etat plateforme, qui a commandé certains dispositifs de l’Etat avec des directions du num’.
Ces logiques sont d’inspiration anglo saxones : l’Etat gouvernement vers l’Etat gouvernance « Big society », « Etat ouvert ».
L'approche structuraliste du récit
La nature de l’Etat mute.
En Europe la société est rendue à l’unité (rationalité) par l’Etat (forme l’espace juridique).
Dans les pays anglo saxons, la défense des droits subjectifs n’est pas principalement organisée par la loi mais la Jurisprudence, la juridicisation des rapports sociaux.
On assiste à un glissement de la rationalité politique, du droit de commandement vers JP ; dont la Constitution qui sert de socle, n’est plus appréhendée seulement sous le prisme de la séparation des pouvoirs, mais aussi d’un point d’équilibre sur lequel s’accorde une société : un récit, qui est négocié, Réflexif, comme témoin des rapports de force dans la dite société.
Le Récit actuel, cherche à rendre du réel négocié, réflexif par la gouvernance du chiffre.
L’Etat créé le droit positif.
La société (multitude) a tendance à l’inverse, à créer des droits subjectifs.
Dans ce schéma, l’individu a des droits subjectifs car reconnus par le droit positif (la loi).
La loi est la source politique du droit.
L'artisanat sEmantique : le negoce du reel.
Le juge répond à la question "Comment parler à l’administration pour que l’administration m’entende ?" par une forme d'artisanat sémantique.

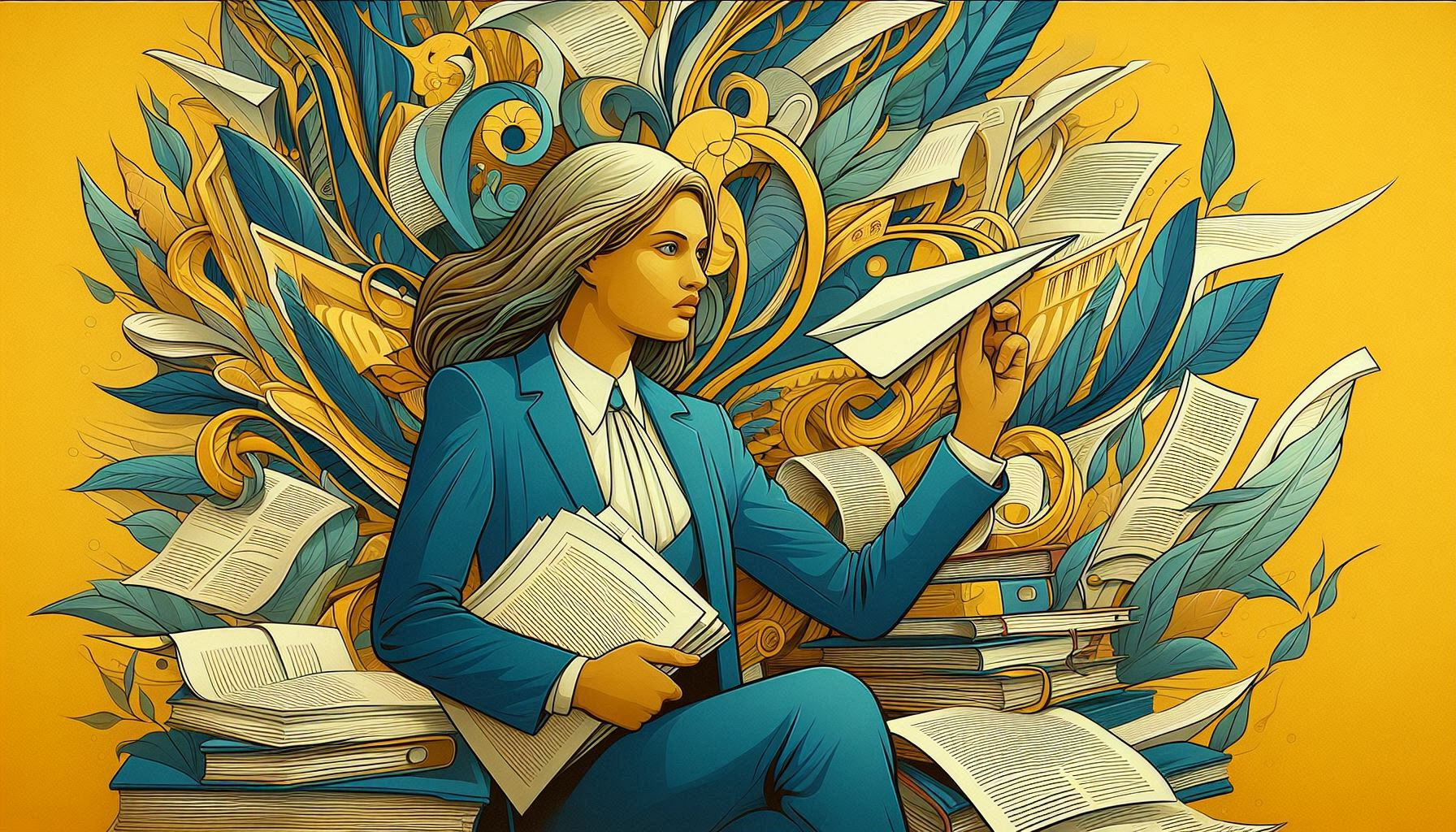
L’autre doit pouvoir reconnaître quelque chose, et le retenir comme pertinent
Par cette utilisation des concepts, l’opérateur juridique amène le problème de son agenda à celui du politique
.
Le juge tente de communiquer avec l'administration
l'administration comprend le sens du concept qu'indique le juge
La semantique vers la rationnalite politique
Cette approche pragmatique qui met en lumière l'artisanat sémantique permet de dégager des schèmes : la rationalisation politique.
Par exemple, la construction rationnelle de l’Etat légal est une volonté politique :
La principale source de l’Etat
est la loi : 3 &4ème Rep, (Carré de Malberg). =>Ce que l’on
doit mettre en œuvre est le souhait de la majorité politique : ceux qui
font la loi.
C'est une Logique de commandement vers une logique politique, un désir de
société « La liberté dans l’ordre ». de la 3ème.
Au cours de la 3eme apparait l’Etat Social, interventionniste qui devient un sous-produit de la
première rationalité (Etat source de loi).
Cet Etat social va
entrainer la prise en compte des individualités collectives, les minorités
(classes ou ethniques).
Dès lors l’Etat se fragmente, et la rationalité
première se désagrège au profit d’une autre rationalité: déconcentration,
décentralisation, régionalisation entre complexité, et rationalités locales.
La décision est un ensemble, le produit, de la pluralité de rationalité (les contraintes).
Dès lors, dans le cas de la mise en oeuvre d'une politique, l’administration « fait semblant » de décider, c’est la mise en place de commission ou encore plus récemment les « consultations citoyennes » => Le Nudge, l’outil « doux » de donner la sensation de résoudre un problème.
Les rouages, les routines, les process éculés habitent l’administration et conditionnent son appréhension de la nouveauté (les problèmes).